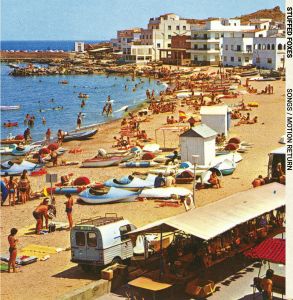Sacré pic démographique pour Guéret : le chef-lieu du département de la Creuse, commune de 13 000 habitants, accueille, sur deux jours, 10 000 festivaliers attirés par l’affiche alléchante du Check-In Party. Le festival, installé sur un aérodrome propose pour la deuxième fois (après la première édition de 2019) une programmation de haute voltige, et ce sera l’unique jeu de mot aéronautique de cet article.
Après 9 heures de route à 7 dans un monospace et une nuit de camping sauvage près d’une ravissante décharge, nous arrivons aux alentours de l’aérodrome de Saint Laurent-Guéret en début d’après-midi, en même temps qu’un couple dans un camion vert. Un défaut de signalisation nous amène, ainsi qu’une bonne autre vingtaine de voitures à ce qu’on a pu en voir, du côté de l’entrée des artistes. L’entrée régulière est située cinquante mètres plus loin, mais la route est barrée. On doit faire le tour en suivant la direction Guéret, Guéret est indiqué dans 2 directions différentes, nous en prenons une, le camion vert prend l’autre, on se paume, on tourne, on coupe à travers champ, on revient à l’entrée des artistes, on repart, un troupeau de vaches emmené par un type à dreadlocks nous barre la route, on se re-paume, on retrouve la camion vert garé dans un champ, le couple est à côté, en position fœtale au bord de la route ; nous prenons leur pouls, comme ils sont encore vivants nous les laissons là pour ne pas nous mettre trop en retard ; nous ne les reverrons plus jamais.
C’est déjà la première aventure de ce festival, une course d’orientation proposée aux voyageurs, nous sommes charmés. Nous trouvons notre chemin en 45 minutes, pas le meilleur score, mais pas le pire non plus. Le temps de monter la tente, nous entrons sur le site du festival en même temps que les membres de Geese entrent en scène.
Geese
Le chanteur bafouille un truc du genre « salut le Check-In, euh, nous sommes Geese, euh, nous venons de New York... » puis hurle un « YEAH » dont on ne sait s’il est destiné à lui-même, un cri mi-de guerre, mi-de panique, ou à la foule apathique qui cligne des yeux comme si elle venait de se réveiller.
Vus quelques semaines auparavant dans des conditions qui leur avaient été très favorables, remplaçant un groupe au pied levé et se présentant donc comme les sauveurs de la soirée, les membres de Geese semblent aujourd’hui un peu moins à l’aise. Le contraste est saisissant entre un set de nuit permettant un jeu de lumière spectaculaire, et ce set inaugurant pour tout le monde la scène Air Force, à 5h de l’aprem.
Malgré de bonnes compositions et les évidentes qualités individuelles de chacun des musiciens, le résultat en est donc un peu moins captivant. La palette des genres est large, avec des sonorités garage et post-punk servant une composition pas du tout flemmarde laissant la place à quelques incursions heavy ou rythm and blues, mais le tout semble un peu trop appliqué. En fait, on aimerait bien un peu plus de sale, de vicieux, histoire d’affûter les angles, de donner un peu de piquant à l’interprétation qui nous paraît parfois surjouée dans l’émotion.
C’est globalement le problème des groupes aux intentions fines et subtiles en festival, qui peuvent souffrir d’un certain manque d’attention, et être tentés de surinvestir pour donner le change, ou encore d’abandonner le combat en expédiant le show. Ici, ça se bat courageusement, mais les efforts ne sont pas récompensés dignement.
La Jungle
Pour ce qui est du vice et de la saleté, La Jungle sait de quoi on parle, et tartine allègrement sa mélasse auditive sur nos visages ravis. Le duo, augmenté d’un looper permettant de renvoyer guitares, synthés et autres maléfices dans la tronche à nous, convainc dès la première minute avec un groove parmi les plus crados du continent. Ça danse et ça pue à la fois, et si l’on ferme les yeux, on se voit sauter dans la fange avec des bottes en caoutchouc. Le son est très personnel, guitares râpeuses, caisse claire rugueuse, il se dégage de tout cela une personnalité particulièrement forte.
Un type complètement ivre se faisant appeler capitaine par à peu près tout le monde jette son calot en l’air, dans la foule, très loin. En moins d’une minute, on lui renvoie, à son grand étonnement. Tout le public est franchement chaud, on a facile une bonne centaine de personnes qui sont déjà au climax de leur soirée en terme d’ambiance et de lent dérèglement des sens, il est 18h15, le titubement est la choré du moment et dans nos cœurs, surpasse la Macarena.
Alors que l’on croyait que la pression avait atteint son seuil maximum, en un break effroyable, le duo se braque et surenchérit sur l’insurenchérissable, nous propulse dans un cosmos boueux où tout n’est plus que décadence et électricité. Un déferlement de violence groovy nous submerge. On en sort avec l’impression d’avoir déjà vu le meilleur concert du festival, en même temps que de s’être fait rouler dessus par un tracteur. Certains, à la sortie, regrettent que le concert n’ait pas été programmé plus tard, nous en sommes très satisfaits : le moment était renversant, pur et sale, sans artifice aucun ; le festival est véritablement lancé.
Last Train
La pluie se met à tomber alors que Last Train entre en scène. Je mets donc mon K-way portant, sur le dos, l’inscription « sécurité ». Logiquement, ça ne plaît pas à la sécurité. Comprenant l’embarras des deux larrons qui m’accostent (un grand et un petit, comme dans les dessins animés), vêtus d’un habit ressemblant effectivement au mien (sauf que eux ne l’ont pas eu à Emmaüs), j’accepte de porter ma veste à l’envers, pour ne pas être confondu, me confondant en excuses. Croyant avoir fait le nécessaire pour rétablir la paix dans le monde, je retourne à ma mission de reporter ; c’était sans compter sur l’abnégation de Minus et Cortex, revenant une minute plus tard pour m’agripper et me prendre en photo sans attendre ma permission. Je proteste devant l’agressivité du procédé, arguant qu’on « n’est pas là pour se faire engueuler », ou à peu près. On m’invite alors à passer derrière une bucolique clôture de canisses, afin de faire plus ample connaissance. On s’explique en toute intimité, une discussion animée où nous échangeons nos points de vue avec passion, élevant épisodiquement la voix, comme ça se fait en bonne société. Le débat dure plusieurs minutes – le temps d’un set, à peu près. Lorsque nous revenons devant la scène, le groupe la quitte.
Ce paragraphe, petite exception à la première personne du singulier, grave pour toujours la première fois où j’eus à retourner ma veste. Les festivals devraient choisir avec parcimonie les sociétés de sécurité avec lesquelles elles travaillent, s’assurer que leur attitude sera en adéquation avec le contexte festif, et que leurs employés ne sont pas simplement des roquets frustrés par leur échec à l’examen d’entrée à la BAC. Au cours du festival, nous aurons d’autres échos du zèle excessif des serviteurs du Titan International. L’ambiance est meilleure quand les festivaliers ne sentent pas posés sur eux le regard d’un vigile les considérant non pas comme des spectateurs, mais comme des potentiels fauteurs de trouble.
Bon, tout ça pour dire que je n’ai pas vu Last Train. Le photographe a dit que c’était très bien.
Shame
Vus dans le même contexte que Geese quelques semaines auparavant, au Pointu Festival, on a, de la même façon, du mal à parler de Shame sans se répéter. Le set est à peu près le même, toujours aussi carré et immersif, et fonctionne très bien sur les festivaliers. L’investissement scénique du groupe est irréprochable, les nouveaux morceaux promettent de belles choses à venir – on note un truc à la limite du Motorhead, c’est dire.
Apparemment, le bassiste nous a fait sa spéciale « salto-schlag couru avec basse dans les mains », c’est le photographe qui nous l’a dit. Il aurait manqué sa réception et traîné la patte quelques minutes, avant de se remettre à courir partout. Comme nous l’avons raté (sans doute parce que nous n’avons d’yeux que pour le batteur, devenu une attraction franchement fascinante depuis l’album Drunk Tank Pink, virtuose métronomique et explosif à la fois), il cherche à tout prix quelqu’un avec qui partager cette anecdote. Nous décomptons au total six individus différents auxquels il posera la même question, « je suis le seul à l’avoir vu ? Le salto du bassiste ? ».
A priori, personne ne l’a vu (sauf une personne mais c’était pas à ce concert-là donc ça ne compte pas). Ainsi nous lançons un appel à témoin. Si vous l’avez vu, le salto du bassiste, merci d’écrire un mail à rock@lagrosseradio.com (mettre en objet : « je l’ai vu, le salto du bassiste »).
Stuffed Foxes
La grosse découverte du jour, et sans doute l’un des moments les plus excitants de cette édition : le show de Stuffed Foxes sur la scène Helicoptere. Bien qu’elle ait un nom absurde, « Helicoptere stage », avec le -e de l’orthographe française mais sans accent, et accolé à un « stage » anglo-saxon ce qui n’est donc pas bien cohérent, cette scène est sans doute la plus belle idée du festival. Sous une petite structure en bois, histoire de soigner la scéno, un petit espace, serré, concentré, permet au public de circuler tout autour du groupe mais aussi de ressentir une véritable proximité avec lui, soit ce qu’il y a de plus grisant dans un concert. Pour ne rien gâcher, le son est excellent, diffusé aux quatre angles, puissant comme il faut, clair, c’est de la grosse régalade.
Les conditions sont donc optimales pour recevoir Stuffed Foxes, appelé pour palier à la défection de Serpent, et qui va opportunément en profiter pour imposer la plus belle des transes collectives du week-end. Le son est massif, plein, tellement englobant que l’on sortira du concert avec une idée très nette de ce qu’on ressent quand on se fait emmurer vivant. Sur scène, les types donnent absolument tout, semblent prendre un pied fou, le spectacle passionne et prend aux tripes : la chair de poule, frère. Cette scène est faite pour eux, ils sont chez eux, on est chez eux, mais chez nous aussi, on est en coloc avec Stuffed Foxes, l’évier de la cuisine déborde de vaisselle sale mais c’est pas grave, on s’en occupera demain.
Si on a bien suivi, Stuffed Foxes joue le seul rappel de tout le festival, le public ayant décidé très fermement qu’il en voulait encore. C’est aussi l’avantage des scènes à 360 degrés : quand les centaines de personnes qui sont là veulent pas que tu descendes, ben tu descends pas.
Fontaines DC
On s’était pas mal ennuyés en entendant le dernier album du quintet dublinois, Skinty Fia, qui nous semblait embrasser tout entier une pose marketing des plus irritantes, servie par une communication plus travaillée que les lignes de chant de Grian Chatten. Au final, si les mélodies vocales restent comprises dans l’intervalle d’une quinte, à tout casser, l’atmosphère compacte produite par le groupe se révèle extrêmement séduisante.
On plonge dans un état d’ébriété musicale, une barre au front, qui ne sera levée en fin de concert que par les quelques deux morceaux issus du premier album, détonantes scansions punkoïdes permettant aux pogoteurs de faire leur office comme une récompense de s’être bien tenus jusque là. Entre temps, des extraits de Skinty Fia, bien plus convaincants sur scène, et de A Hero’s Death, tout aussi attachants, avaient formé une masse gazeuse épaisse et addictive. On pourrait reprocher au groupe cette uniformité, nous sommes en fait séduits par cette minuscule marge de manœuvre qu’il se laisse à lui-même et dans laquelle il parvient à développer une micro-nuance assez fine. Une toute petite lucarne dans une pièce sombre, par laquelle passerait un tout petit arc-en-ciel, si on devait placer une métaphore mièvre.
Le décor à l’arrière, classe, simple mais soigné, contribue à l’hypnotisme du moment, et l’on reste absorbé tout du long. Fontaines D.C. conclut sur le titre "I Love You", que l’on déteste heureusement toujours, comme pour s’assurer charitablement que l’on reste bien en accord avec nous-mêmes. Les types sont sympas quand même.
Slift
Quand on les a connus, ils étaient petits comme ça, et regarde les beaux jeunes hommes qu’ils sont maintenant. En 2018, Slift sortait son album La Planète Inexplorée chez Howlin Banana Records, et faisait passer sa tournée par la Salle Gueule, petite salle punk marseillaise d’une capacité maximale de 80 personnes en empilant les gens. Depuis, le trio est tout simplement devenu monstrueux. Si l’on ne pouvait pas tenir debout sans même toucher les pieds par terre tellement on est serrés, on tomberait à genoux. La maîtrise est impressionnante, les compositions sont des histoires passionnantes – même pour quelqu’un qui vomit à la simple mention du concept de « guitar hero ».
Jamais une once de prétention ne vient obscurcir le tableau, il ne brille que de l’éclat parfait du talent pur et du dur labeur. Ça pue le travail à plus de 35h/semaine, une furie impeccablement maîtrisée. On se dit des tas de choses très enthousiastes : que dans un délire comparable, le trio n’a absolument rien à envier à des Osees ou consorts ; que la France a enfin produit un vrai groupe international ; qu’au niveau national, si le rock intéressait encore les masses, Slift aurait complètement effacé Noir Désir, Téléphone, et même Eddy Mitchell, tiens.
Leur tournée aux Etats-Unis est en train de virer sold out partout, ils vont conquérir le monde et si un jour on entre en contact avec une civilisation extraterrestre, c’est Slift qu’on enverra pour vérifier si les aliens ont un cœur.
The Libertines
Programmés en remplacement de King Gizzard and the Lizard Wizard, les Libertines sont une belle prise de dernière minute pour le Check-In Party. Preuve que le monde a bien changé depuis les années 2000, Pete Doherty monte sur scène à l’heure, et même à la minute.
Au-delà de la ponctualité, on sent que pas mal de choses ont été lissées, y compris l’interprétation des morceaux, un peu automatique et manquant de quelque sauvagerie. La setlist est sans surprise, ce sont les tubes du groupe qui sont joués à la file, et plutôt fidèlement aux versions que l’on connaît sur album. Une petite exception, un phrasé sur le titre "What Katie Did?" visitant une gamme orientale le temps de deux-trois notes, nous permet de mettre le doigt sur ce sentiment d’anachronisme qui nous traverse tout au long du set. La musique des Libertines, qui avait très largement contribué à définir l’identité sonore des années 00, ne colle pas avec notre époque où précisément, on se tartine de gammes riches, d’arrangements fat remplissant massivement tout le spectre des fréquences… Ici, très éloigné de ces standards en cours, le son du groupe paraît tout petit, fragile, désuet. Comme si on nous proposait un délicat velouté de poireau, à l’assaisonnement minimaliste, alors qu’au quotidien, on se crame la gueule avec des plats gras et ultra-pimentés. Ce ne remet pas en cause la qualité du velouté : simplement nos papilles ne sont plus aptes à l’apprécier.
Le moment reste agréable tout de même, parce que même si l’on n’est jamais surpris, la qualité des morceaux n’est pas usurpée. En plus, il se met à pleuvoir, ce qui force un peu tout le monde à remuer son derche, c’est la danse ou la crève, et l’on choisit la danse.
Lucie Antunes
Trempés jusqu’aux os malgré la qualité indéniable de notre K-way « sécurité » toujours retourné, et tombant de fatigue après une journée de voyage et ce marathon infernal qu’impose l’excellence de la programmation du Check-In (pas de pause, quand tout est bon, on ne veut rien rater), on peine à se concentrer sur le show pourtant hautement qualitatif de Lucie Antunes. Le charisme, le dynamisme, le jeu de lumières ultra-prenant, tout est là, mais quand le cerveau n’enregistre plus, on ne peut plus rien faire. En tout cas, on n’aura pas le moindre écho négatif de cette performance, qui a manifestement été l’un des nombreux sommets de cette soirée.
On rentre donc s’évanouir au camping, en espérant que l’on se réveillera le lendemain. Cette première journée est donc particulièrement convaincante, en même temps que sacrément sportive, les concerts s’enchaînant à une cadence difficile à suivre, on regretterait presque le sans-faute des programmateurs. Voilà donc notre suggestion pour les prochaines éditions : essayez de nous mettre un groupe un peu naze vers 21-22h, histoire de souffler un peu.
Photos : Thomas Sanna