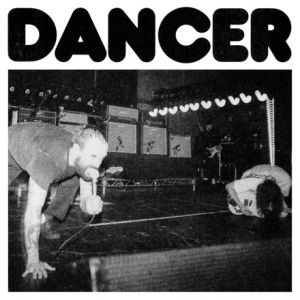03/06/18 - Dernier des trois jours du This Is Not A Love Song à Nîmes. Des festivaliers hagards arpentent le site en essayant d'oublier leur gueule de bois dominicale. Comme le duo Loheem, programmé cet après-midi a écrit une chanson avec une école élémentaire de la ville, beaucoup de familles profitent de cette après-midi gratuite pour éduquer leurs enfants aux principes fondamentaux de la perversion jouissive de la culture rock'n'roll.
Certains sont déjà au cœur des événements, organisent des concours de houla-hoop à côté des caravanes, tissent des fresques de coton sur les grillages de Paloma, chantent sur les scènes ou interviewent les programmateurs à l'espace presse. Après nous avoir tiré une pinte, un garçonnet de huit ans nous propose un cigare cubain en crachant par terre ; nous refusons poliment.
FABULOUS SHEEP
A 15h10, Fabulous Sheep nous montre quel genre de concert il faut faire pour commencer devant une fosse vide, et terminer devant une fosse pleine. Le quintet biterrois envoie avec une énergie de vilain hooligan des titres à la dimension mélodique travaillée, immédiatement addictive. Trois voix se partagent la tâche, individuellement, empêchant toute éventuelle lassitude à l'écoute, ou collectivement, lorsque les refrains, scandés en chœur, deviennent de véritables hymnes générationnels – c'est d'ailleurs ce que semble vouloir proposer le groupe, visiblement obsédé, dans ses textes, par ces questions de générations, de jeunesse, de rassemblement. Pendant ce temps, le clavier saupoudre le tout d'une sorte de mélancolie lumineuse, et le batteur éclabousse ses toms de la sueur de son torse nu.
Le gros point fort du groupe réside sans doute dans sa maîtrise impressionnante des ambiances et des intensités, passant du bruyant au tamisé sans que l'investissement dans l'interprétation ne se perde à aucun moment ; une bonne gestion des temps forts et des temps faibles, comme dirait Didier Deschamps. Le titre "Kills Me Slowly" donne lieu à un jeu de silence prenant ; il faut une sacrée paire d'audaces pour s'enfermer dans un mutisme total sur scène, s'y tenir, et surtout, l'imposer autoritairement à une foule enthousiaste et avinée, foutrement effrayée par ce silence pesant ; ça fonctionne parfaitement. Le groupe offre tout de même la perspective d'une catharsis à son public, histoire d'évacuer la tension qu'ils ont eux-mêmes injectée : aux mots « bagarre générale », c'est un déchaînement de violence, ça se frappe dans tous les sens, un type s'éclate un verre sur la tête et le bassiste descend se faire molester par les spectateurs. C'est bien.
LES LULLIES
Quelques minutes avant que le festival n'entre dans sa phase payante, un speaker, après avoir évoqué la nuit qu'il vient de passer avec 40 agents de sécurité, demande courtoisement aux spectateurs ayant acheté leur place de se mettre à poil, afin que puisse enfin commencer le premier grand festival nudiste. Même si cela ne sera pas suivi d'effet, nous saluons l'initiative.
Il pleut lorsque Les Lullies entrent en scène, le parterre est dépeuplé, ça tire un peu la gueule. De mémoire, il n'avait encore jamais plu lors d'un TINALS ; les festivaliers, jusque là opportunément abrités tout autour du bar, bravent la flotte et déboulent dans la fosse dès les premières notes, le groupe montpelliérain est apparemment assez attendu. « Ah, y'a du monde quand même », ça ne tire plus la gueule du tout. Plusieurs personnes sont là juste pour le plaisir de revoir les deux membres du groupe qui avaient enflammé la Mosquito et le Patio l'an dernier, avec les Gry-Grys. Pas de garage sixties ici, on parle plutôt de « punk 77 », un genre qui semble pouvoir offrir un peu plus de diversité dans la composition.
Et c'est effectivement un show bien punk qui est envoyé : on enchaîne tout rapidement, c'est à peine si chaque morceau ne commence pas avant la fin du précédent, les rythmiques sont tendues, tout est joué à balle, ça trace, les mecs parlent à toute vitesse dans le micro en serrant les dents sans souffler. Les morceaux ont certainement été structurées par un hyperactif au cœur s'emballant facilement, on passe d'un idée à l'autre en un instant, sous l'impulsion d'une section rythmique au taquet, une dynamique implacable reposant visiblement sur la bonne frappe d'un bon batteur, sur de bonnes grosses lignes de basse bien pures.
THE BREEDERS
Les sœurs Deal effectuent un retour assez attendu au TINALS, après leur premier passage en 2013, lors de la toute première édition du festival. Si l'éclatante bonne humeur de Kim Deal est particulièrement contagieuse, le show manque tout de même de rebondissements pour nous convaincre tout à fait. Les titres sont courts, joués avec une demi-mollesse un peu paresseuse. On passe quelques minutes voir Ezra Furman sur la scène Bamboo, qui évolue dans un registre d'émotions assez contrastées, intéressant.
Lorsque l'on repasse devant la Flamingo, la fosse s'est un peu vidée mais le public restant danse joyeusement sous la pluie. On est mitigé par la reprise de "Gigantic", titre que Kim Deal chantait avec les Pixies, dans l'temps : heureux de l'entendre chanter cet excellent titre évocateur de mille souvenirs pour chacun des spectateurs, mais doutant un peu de sa légitimité dans un set des Breeders.
IDLES
Devant un très joli fond à fleurs d’un rose doux et raffiné, Idles va livrer, dans la Grande Salle, la prestation la plus furieuse de cette édition. Rien à redire sur le son cette fois (comme à chaque fois dans la Grande Salle, d’ailleurs), le crade-corrosif des guitares est limpide, les voix beuglées sont bien propres. Les Anglais distillent leur punk sec et froid avec une efficacité irréprochable, grâce à un set trouvant un équilibre idéal entre le rôdé et le spontané.
C’était donc l’exact bon moment dans leur carrière pour programmer Idles, un groupe typiquement en pleine adolescence : grandit chaque jour, bouffe comme quatre, étonne une fois de temps en temps par son éclatante lucidité, sa maturité inattendue, mais est également plein de troubles du comportement incompréhensibles et d’extraversions espiègles et absurdes (tenter de faire chanter "All I want for Christmas is you" au public avant de se rendre compte que la chanson est sans doute moins incontournable en France qu’en terres anglophones). Il s’engage également, prend position avec un sentimentalisme renversant, hurle son amour pour les migrants une bonne douzaine de fois d’affilée, faisant dresser poings dans la salle et poils sur les bras.
L’activité, sur scène comme dans le public, est incessante, le roi des brutes, au chant, arpente la scène comme un fauve tandis qu’un photographe accrédité s’offre un slam-vidéo. Les guitaristes passent plus de temps dans la fosse que sur les planches, sans jamais relâcher leur maîtrise technique impeccable. Ils finissent le concert à jouer ensemble portés par la foule. Paloma est soufflée et, lorsque les lumières se rallument, les secours s’affairent à relever en urgence une foule de festivaliers tombés sur le cul. Beaucoup n’auront plus les jambes pour poursuivre, se dirigent vers le parking dès la sortie de la salle, exténués et heureux.
DEAD CROSS
C’est aussi que la programmation de Dead Cross en clôture du festival ne fait pas l’unanimité. Pourtant, il s’agit d’un rendez-vous délirant qui s’impose de plus en plus dans l’ADN du festival, une tradition à laquelle on souscrit sans réserve : chaque année, un groupe complètement désassorti avec le reste des artistes est invité à livrer une prestation violente pour choquer la Denise et faire faner les dernières fleurs sur la tête des festivaliers. L’an dernier, c’était Turbonegro ; ce soir, c’est Mike Patton et ses nouveaux copains, une bande de bouchers aussi méchants que bruyants, parmi lesquels le jeunot Dave Lombardo, de Slayer.
Et c’est effectivement un pugilat bien structuré qui éclabousse les quelques rangées de spectateurs survivants. Malgré des temps un peu longs entre les morceaux (ils pourraient s’inspirer, par exemple, des Lullies, qui savent maintenir la tension), Dead Cross joue impeccablement de ses fractures malsaines et de ses grands écarts ambiants propres au style Patton. On ressent une certaine tristesse dans toute cette violence, ou une certaine violence dans toute cette tristesse, on ne sait plus.
BILAN
C’est donc sur une ultime beigne expiatoire que se conclut ce sixième This Is Not a Love Song. Si l’on nous avance que le nombre de spectateurs est à peu près le même que celui de l’an dernier, il nous semble tout de même que le site était un peu moins peuplé pour cette édition. Sans doute moins de Pass 3 jours vendus, plus de festivaliers éphémères. C’est que le camping se fait toujours attendre, et que la programmation, à première vue, en bouchait un plus petit coin que l’an dernier ; la qualité intrinsèque n’a pas diminué cela dit, les découvertes sont toujours aussi jouissives. On n’a pas tenté la grosse surenchère surfant sur le succès précédent, on maintient le festival à un niveau de fréquentation raisonnable, et à une haute qualité de programmation, c’est parfait, c'est ce dont le monde a besoin.
Le point négatif :
Les ingés son des scènes extérieures sont probablement des teufeurs en redescente d'ecsta, seule explication que nous avons trouvé à cette passion débordante pour les basses et les grosses caisses.
Le point positif :
Les groupes qui laissent la meilleure impression ne sont pas les têtes d’affiche, mais bien les petits groupes du coin (Fabulous Sheep, Les Lullies, The Spitters...) et les moyens groupes d’autres coins (Moaning, The Buttertones, Chocolat...) ce qui est mine de rien un constat extrêmement optimiste : on ne va pas s’emmerder pendant les prochaines années.
Étant en interview, nous avons raté Black Bones, pas notre photographe...
Crédits photos : Thomas Sanna / Yann Landry (Idles)























![[MAJ] TINALS : programmation complète !](https://cdn1.lagrosseradio.com/wp-content/uploads/2020/12/21107.jpg)